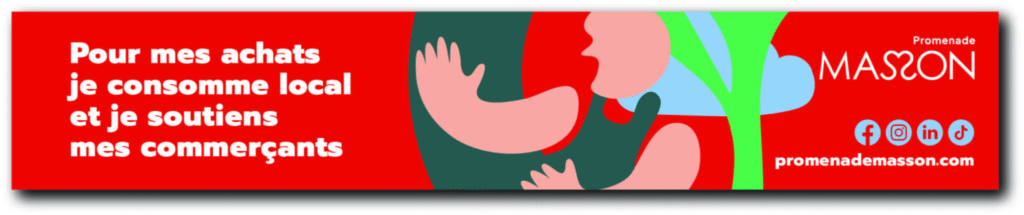Roger-Luc Chayer (Image : Meta IA / Gay Globe)
La crise du logement dans les grandes villes occidentales
Nous traversons une période particulièrement critique en matière de logement dans les grandes villes occidentales, un phénomène qui s’est aggravé depuis la pandémie de 2020.
À Paris, Montréal ou Los Angeles, la crise est visible à chaque coin de rue. Sous l’effet de la spéculation immobilière, les loyers atteignent des sommets inaccessibles pour une part croissante de la population. En parallèle, les campements se multiplient, devenant le refuge de personnes issues de milieux sociaux très différents mais unies par un même constat : celui de ne plus pouvoir se loger dignement dans leur propre ville.
La population de ces campements est composée d’un mélange hétérogène de personnes que la crise du logement a progressivement marginalisées : on y retrouve aussi bien d’anciens locataires expulsés que des travailleurs précaires dont le revenu ne suffit plus à couvrir un loyer, des jeunes en rupture familiale, des personnes âgées isolées ou encore des migrants récemment arrivés.
Tous partagent une même réalité : celle d’avoir été exclus du marché résidentiel traditionnel et de devoir recréer, dans ces espaces improvisés, une forme de communauté et de survie.
Nous savons aussi que les gais et les lesbiennes représentent une proportion anormalement élevée de cette population, souvent en raison du rejet de leur famille lié à leur orientation sexuelle.
Faut-il miser sur la construction pour sortir de la crise du logement ?
Il ne fait aucun doute que la construction de nouveaux logements sociaux est nécessaire et qu’un investissement majeur sera requis si l’on souhaite sortir de la rue la plupart de ces personnes qui n’auraient jamais dû s’y retrouver.
Mais manque-t-il vraiment de logements au point de justifier une telle crise sociale, ou certains spéculateurs et propriétaires maintiennent-ils volontairement des centaines, voire des milliers, de logements vacants afin de faire grimper les prix artificiellement ?
La crise du logement à Paris, Montréal et Los Angeles ne tient pas seulement au manque d’appartements : elle reflète surtout une spéculation qui laisse vacants des logements pourtant indispensables, gonflant les loyers et jetant des milliers de personnes dans la rue.
Dans chacune de ces villes, la spéculation et l’accaparement de logements par des investisseurs contribuent à maintenir les loyers à des niveaux inaccessibles et à laisser de nombreux appartements vacants.
À Paris, la pression touristique et la multiplication des locations de courte durée réduisent l’offre pour les résidents. À Montréal, l’achat massif par des investisseurs privés éloigne des locataires qui peinent à se loger, tandis qu’à Los Angeles, la combinaison de la demande écrasante et d’une régulation insuffisante crée des logements hors de portée pour beaucoup.
Partout, le problème est moins l’insuffisance de construction que la manière dont certains acteurs du marché exploitent la rareté pour maximiser leurs profits, laissant les plus vulnérables dans la rue ou dans des campements improvisés.
Faut-il miser sur les subventions plutôt que sur la construction ?
Construire du neuf coûte une fortune. Permis, ingénieurs, architectes, achat de terrains, infrastructures pour l’eau, l’électricité et les égouts, installation des technologies pour l’internet et les services publics… la facture grimpe vite.
Plutôt que de dépenser des millions pour créer de nouveaux logements, pourquoi ne pas investir dans ceux qui existent déjà et qui sont parfaitement fonctionnels ? La question est simple, et les économies pourraient être colossales.
Prenons le cas de Madame Lapierre, par exemple. Elle possède un appartement de trois pièces à Montréal et paie un loyer de 1 150 $ par mois, en plus des frais d’électricité, de téléphone et d’internet, sans compter l’épicerie et les petites dépenses quotidiennes comme le transport. Ses revenus nets de travail se limitent à environ 1 900 $ par mois, une fois les impôts et les cotisations sociales déduits. Madame Lapierre n’a aucune possibilité d’augmenter ses revenus et risque de perdre son appartement chaque mois.
À Montréal, un logement de 3 pièces fait une superficie d’environ 800 pieds carrés. En prenant une fourchette de coût de 165 $ à 300 $ par pied carré, le coût total de construction serait compris entre 132 000 $ et 240 000 $.
Au-delà du coût de construction, il faut également tenir compte des dépenses supplémentaires qui peuvent rapidement faire grimper la facture. Les honoraires pour les plans réalisés par un architecte ou un technologue en architecture varient généralement entre 4 000 $ et 10 000 $, tandis que certaines installations particulières, comme les puits, les fosses septiques ou les branchements aux services publics, peuvent coûter de 1 000 $ à 15 000 $ selon les besoins.
À cela s’ajoutent divers frais administratifs, incluant les services notariaux et les taxes de bienvenue, qui se situent en général entre 1 000 $ et 2 500 $, ce qui illustre bien l’ampleur des coûts supplémentaires liés à la construction d’un logement.
En complément à ces investissements absolument nécessaires on en conviendra, pourquoi est-ce qu’un programme d’aide au logement crédible et conséquent ne serait pas mis en place pour subventionner le logement de Madame Lapierre lui évitant un déménagement, les conséquences de se retrouver à la rue et les économies pour l’État pourraient être très importantes.
Et si une allocation logement pouvait changer la donne ?
Si une aide de 25 % était accordée à Madame Lapierre, son loyer diminuerait de 287,50 $, passant de 1 150 $ à 862,50 $, ce qui représente une baisse considérable. Mais au-delà de la subvention directe aux locataires, l’État pourrait également mettre en place un programme d’entretien résidentiel pour les propriétaires, afin que leurs logements subventionnés conservent leur valeur au fil du temps.
Même si ce programme offrait aux propriétaires un montant de 500 $ par mois, soit 6 000 $ par an, pour l’entretien et la rénovation de leurs logements, cette somme serait non seulement appréciable pour eux, mais le total combiné de l’allocation aux locataires et de la subvention aux logements resterait bien inférieur au coût de construction de logements neufs, tout en permettant à des milliers de locataires de ne pas se retrouver à la rue.
En temps de crise, il faut penser moins comme un investisseur et plus comme un gestionnaire social.
Logements vides : faut-il une loi pour contraindre les spéculateurs ?
Nonobstant les mesures possibles mentionnées plus haut, il serait également temps d’envisager la mise en place des législations nécessaires pour contraindre les propriétaires spéculateurs à louer leurs logements vacants, en rendant illégal le maintien d’un parc immobilier non exploité.
Une taxe sur les logements inoccupés pourrait constituer une solution efficace. Les revenus générés pourraient financer les allocations logement et les programmes d’entretien pour les propriétaires, réduisant ainsi le fardeau financier de l’État. Un propriétaire soumis à une taxe de 500 $ par mois et par logement inoccupé subirait rapidement des pertes importantes.
Dans ces conditions, il aurait tout intérêt à louer rapidement ses logements pour éviter la taxe, tout en bénéficiant de l’aide à la rénovation. Une approche pragmatique et avantageuse pour tous.
Pourquoi les autorités n’ont-elles pas déjà agi ?
Pourquoi les autorités n’ont-elles pas déjà envisagé de telles solutions, à la fois simples et potentiellement très efficaces ? C’est une bonne question, mais les élections offrent toujours l’occasion de soulever ces enjeux, et il ne faut pas hésiter à confronter les élus à ces alternatives lorsqu’une telle opportunité se présente.
PUBLICITÉ