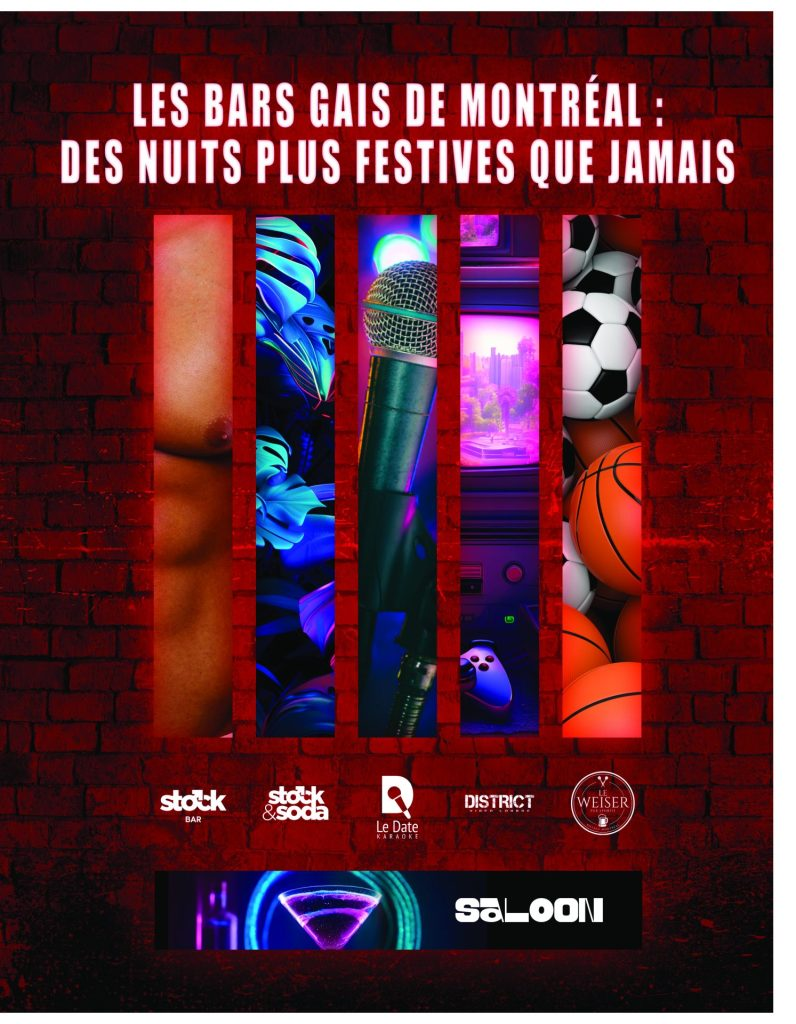Gay Globe et Direction régionale de santé publique de Montréal (Image : Meta IA / Gay Globe)
DU JAMAIS VU DEPUIS 2020 : DEUX SOUCHES RÉSISTANTES PRÉSENTES À MONTRÉAL !
La gonorrhée connaît une progression fulgurante à Montréal
La gonorrhée connaît une progression fulgurante à Montréal. En 2024, la Direction régionale de santé publique (DRSP) a recensé 5 458 cas d’infection gonococcique, un chiffre record en 25 ans. Cela représente un taux d’incidence de 257,3 cas pour 100 000 personnes-années, un niveau jamais observé dans la métropole.
Si les hommes demeurent les plus touchés, avec 4 453 cas (419,3 cas par 100 000), la situation évolue rapidement du côté des femmes, qui comptent désormais 924 cas (85,9 cas par 100 000). Entre 2020 et 2024, l’incidence a bondi de 112 % chez les femmes, contre 63 % chez les hommes, une inversion de tendance qui préoccupe les autorités sanitaires.
Infection transmissible sexuellement en forte hausse à Montréal
La gonorrhée, une infection transmissible sexuellement causée par la bactérie Neisseria gonorrhoeae, peut souvent passer inaperçue, mais ses conséquences peuvent être graves. Non traitée, elle provoque des douleurs chroniques, des infections des organes reproducteurs, une baisse de fertilité et, plus rarement, une infection disséminée pouvant toucher les articulations ou le cœur. Elle augmente aussi la vulnérabilité à l’infection par le VIH et peut être transmise de la mère à l’enfant lors de l’accouchement, causant parfois des complications sévères chez le nouveau-né.
Des souches résistantes identifiées à Montréal
La hausse des cas s’accompagne d’une préoccupation supplémentaire : la résistance croissante de la bactérie aux antibiotiques. En 2024, deux souches résistantes à une céphalosporine de 3e génération (ceftriaxone ou céfixime) ont été détectées dans la région, alors qu’aucune n’avait été signalée depuis 2020. Cette découverte confirme l’importance d’une surveillance microbiologique constante et du renforcement du dépistage par culture, afin de détecter les résistances et d’ajuster les traitements.
Un profil d’infection qui évolue
La gonorrhée touche aujourd’hui principalement les adultes sexuellement actifs, et non seulement les jeunes. Environ 82 % des cas concernent des hommes, mais la progression rapide chez les femmes de 25 à 34 ans attire particulièrement l’attention. Les zones d’infection les plus fréquentes sont la gorge (41 %), l’urètre (25 %) et le rectum (25 %), des données qui rappellent la nécessité de dépister l’ensemble des sites d’exposition lors des rapports sexuels oraux, anaux ou vaginaux.
Plus de la moitié des femmes (56 %) et plus du tiers des hommes (36 %) diagnostiqués en 2024 n’avaient aucun antécédent d’infection transmissible sexuellement (ITS), ce qui démontre que la gonorrhée peut toucher toute personne sexuellement active, même sans facteur de risque apparent.
Prévention et dépistage : les piliers de la lutte contre la gonorrhée
Les autorités de santé publique insistent sur l’importance de maintenir des pratiques sexuelles sécuritaires et un dépistage régulier, surtout en cas de partenaires multiples. Le condom demeure le principal outil de prévention, puisqu’aucun vaccin n’existe encore contre la gonorrhée.
Fréquence du dépistage et bonnes pratiques
Les experts recommandent un dépistage annuel pour les personnes de moins de 30 ans, et tous les trois à six mois pour celles ayant plusieurs partenaires. En cas de diagnostic positif, il est essentiel de s’abstenir de relations sexuelles pendant au moins sept jours après le traitement, d’effectuer un test de contrôle trois semaines plus tard, et d’informer ses partenaires des 60 derniers jours afin qu’ils soient dépistés à leur tour.
Outils complémentaires de prévention
Certaines stratégies complémentaires, comme la PrEP (prophylaxie préexposition au VIH), la doxycycline post-exposition (Doxy-PEP) ou encore la vaccination contre le VPH, les hépatites A et B et le mpox, peuvent aussi contribuer à la réduction des risques d’infection.
Dans un contexte de résistance croissante aux antibiotiques, la DRSP appelle à une mobilisation collective pour freiner la propagation de la gonorrhée et préserver l’efficacité des traitements existants.
Danger de décès lié à la gonorrhée résistante aux antibiotiques
Il existe un danger réel, quoique rare, de décès lié à une gonorrhée résistante aux antibiotiques, surtout lorsque l’infection n’est pas traitée ou qu’elle ne répond plus aux traitements habituels.
Une infection potentiellement mortelle en cas de résistance
La gonorrhée est causée par la bactérie Neisseria gonorrhoeae, qui infecte principalement les muqueuses génitales, anales ou buccales. Lorsqu’elle est traitée rapidement avec les bons antibiotiques, elle guérit sans complication. Cependant, le problème majeur aujourd’hui vient de l’émergence de souches résistantes aux médicaments utilisés pour la combattre, notamment les céphalosporines de 3e génération (comme la ceftriaxone), qui représentent le traitement de dernier recours.
Quand une infection gonococcique est résistante à plusieurs antibiotiques, elle peut persister et se propager dans l’organisme. Dans les cas graves, la bactérie peut pénétrer dans le sang et provoquer ce qu’on appelle une infection gonococcique disséminée (IGD). Cette forme rare mais sérieuse peut causer :
- une septicémie (infection généralisée du sang),
- une arthrite purulente (infection des articulations),
- une endocardite (infection du cœur),
- ou une méningite (infection du cerveau et des méninges).
Ces complications, si elles ne sont pas traitées à temps ou si les antibiotiques disponibles ne sont plus efficaces, peuvent effectivement conduire à un décès.
Un risque rare mais réel reconnu par l’OMS
Le danger réside donc moins dans la gonorrhée “classique” que dans la possibilité croissante qu’elle devienne incurable à cause des résistances. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) considère d’ailleurs la gonorrhée comme une menace mondiale urgente, estimant que certaines souches pourraient devenir totalement résistantes à tous les traitements connus.
La mort par gonorrhée est exceptionnelle, mais le risque augmente avec la résistance bactérienne. D’où l’importance du dépistage précoce, du traitement adapté et du suivi médical pour éviter la propagation de souches résistantes.
PUBLICITÉ