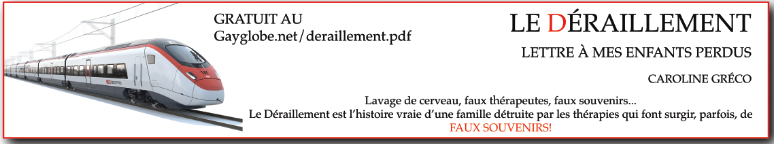Par: Carle Jasmin et Arnaud Pontin (Image: Générée électroniquement ©Gay Globe)
Ah, voilà revenu le temps glorieux du pinkwashing : cette merveilleuse saison où toutes les entreprises, les marques, les politiciens et les institutions nous aiment d’un amour débordant. À tel point qu’ils veulent porter nos couleurs partout où c’est possible, qu’ils vont jusqu’à s’identifier à nos communautés LGBTQQIP2SAA.
Ils nous aiment, mais alors pas qu’un peu. Ils nous désirent, ils nous veulent ! Au fond, ils veulent notre bien — et ils entendent bien se l’avoir. Le pinkwashing, c’est cette grande parade annuelle où banques, géants du pétrole, partis politiques et multinationales se découvrent soudain une passion débordante pour les droits LGBTQ+.
Pendant quelques semaines, le logo arc-en-ciel remplace le bon vieux logo corporatif, les campagnes publicitaires se parent de drag queens et les PDG se déclarent alliés, la main sur le cœur — surtout devant les caméras. Tout cela, bien sûr, sans jamais remettre en question les licenciements discriminatoires, les dons à des partis hostiles aux droits queer ou les marchés florissants dans des pays où l’homosexualité est criminalisée.
C’est un peu comme vendre du savon en affirmant qu’il lave aussi l’hypocrisie. Le pinkwashing, c’est l’art de faire croire qu’on milite, alors qu’on markete. Ce n’est pas une lutte, c’est une stratégie de marque, où l’arc-en-ciel devient un code couleur rentable. Après tout, l’amour gagne… surtout quand il fait grimper les profits. Mais au bout du compte, ces mêmes entités s’éclipseront de notre univers — et surtout de notre fierté — en nous laissant croire qu’elles veulent notre épanouissement. Un épanouissement bien temporaire, limité au seul mois des profits.
Le pinkwashing, c’est aussi une sorte de mascarade, un carnaval, une espèce d’Halloween où ceux qui ne sont habituellement pas des nôtres se déguisent en alliés, arborent nos couleurs, dansent à nos côtés pour mieux capter notre attention. Ils veulent nous imiter pour paraître plus sympathiques, plus inclusifs — du moins à nos yeux.
Mais nous ne sommes plus en 1985 : nous ne sommes plus dupes. Nous savons très bien qu’une fois la saison terminée, ils disparaîtront comme ils sont venus. Pire encore : plus aucun retour de courriel, plus d’appels, et certainement pas l’ombre d’une subvention. Le pinkwashing et l’effacement identitaire sont liés par un même mécanisme d’appropriation. En se drapant des couleurs de la diversité, des institutions dominantes donnent l’illusion d’inclusion, mais souvent au prix d’une dilution des réalités spécifiques des communautés LGBTQ+.
Elles adoptent les symboles sans en porter le sens, l’esthétique sans l’histoire, les slogans sans les luttes. Ainsi, ce qui était politique devient décoratif, ce qui était marginal devient marketing. L’identité n’est plus vécue, elle est exploitée.
L’effacement survient quand les voix dissidentes, les vécus complexes, les combats encore brûlants sont remplacés par des images lisses, rassurantes, consommables. Le pinkwashing ne célèbre pas la différence, il la neutralise. Il ne nous reconnaît pas, il nous recycle. Au lieu de donner une place, il prend la nôtre. Et ce qui reste de nous, après la fête, tient rarement dans une campagne publicitaire.
Dans nos élans journalistiques les plus fantasmés, on rêve parfois d’une édition spéciale où le nom de ces entités serait publié noir sur blanc. Mais nous n’en sommes pas encore là… quoique.
PUBLICITÉ