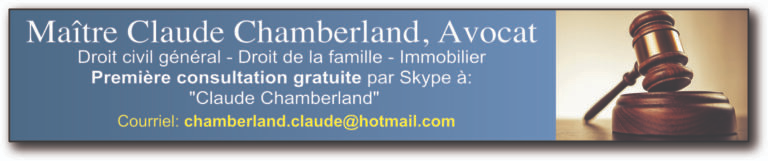Roger-Luc Chayer (Image : Pixabay)
Chaque année, dans de nombreux pays et villes à travers le monde, se tiennent des événements de la Fierté LGBTQ+ qui célèbrent la diversité, l’inclusion et le parcours de ces communautés, dans un esprit positif et festif. Toutefois, un grand nombre de personnes réagissent mal à ces célébrations, sans toujours comprendre pourquoi.
Certaines vivent cette période comme une montée d’anxiété ou l’apparition d’une forme de dépression saisonnière, mais en plein été. Pour certains, l’isolement devient alors un moyen de traverser une période qui génère des émotions trop intenses pour être supportables. Ces personnes, qui font elles aussi partie des communautés LGBTQ+, méritent qu’on s’attarde à leur réalité et qu’on cherche à les soutenir lorsque cela est possible.
Qu’est-ce qui génère ces sentiments ?
Ces réactions parfois douloureuses trouvent leurs racines dans des réalités intimes et complexes. Pour plusieurs, la période de la Fierté vient raviver des blessures anciennes, le sentiment d’exclusion ou l’impression de ne pas correspondre à l’image festive et assumée que projettent ces rassemblements.
D’autres ressentent une pression à afficher artificiellement une joie et une liberté qu’ils ne vivent pas ou plus, ce qui peut accentuer un sentiment de décalage ou de solitude.
Il y a aussi ceux pour qui ces célébrations mettent en lumière l’absence de réseaux de soutien, l’éloignement de proches ou la crainte du jugement, même au sein de leur propre communauté. Enfin, l’exposition constante à des images de fierté, de fête et de solidarité peut, paradoxalement, amplifier le malaise chez celles et ceux qui vivent encore la peur du rejet, le deuil de relations familiales perdues ou une identité encore fragile, difficile à affirmer dans leur quotidien.
Derrière les drapeaux colorés, il existe donc une part d’ombre qu’il importe de reconnaître, pour ne pas laisser seuls celles et ceux que la Fierté fait souffrir en silence.
Le témoignage de Noah
Noah, vingt-trois ans, regarde par la fenêtre de son petit appartement du centre-ville de Montréal, là où flottent déjà les premiers drapeaux arc-en-ciel annonçant l’arrivée de la Fierté. Depuis quelques jours, il sent monter en lui cette crispation familière qu’il n’ose nommer, un mélange d’angoisse sourde et de lassitude qu’il peine à expliquer à ses amis quand ils l’invitent à participer aux festivités. Il voudrait, comme eux, se laisser gagner par la musique, les rires et les couleurs, mais son corps refuse, sa tête aussi. Il ressent une énorme angoisse qu’il ne peux ni expliquer ni exprimer.
Noah se souvient encore de ses premières marches, quand il avait dix-sept ans et qu’il croyait que tout serait réglé une fois qu’il oserait marcher fièrement, main dans la main avec un garçon qu’il aimait un peu trop. Il croyait que l’acceptation de soi viendrait comme un feu d’artifice, éclatant et définitif. Pourtant, chaque année, il réalise que la fierté affichée n’efface pas les égratignures intérieures.
Dans la foule, il aperçoit parfois des regards, des sourires, des drapeaux plus grands que nature, mais aussi, dans l’ombre, la solitude qui lui colle à la peau quand il rentre seul chez lui après avoir souri trop fort pour rien.
Depuis qu’il a quitté la maison familiale, où son père ne comprendra jamais et où sa mère fait semblant d’ignorer, Noah vit entre deux mondes. Celui qu’il montre sur ses réseaux sociaux, fait de photos de soirée et de sorties entre amis, et celui qu’il tait, peuplé de doutes et de lourds silences. Chaque été, cette faille se rouvre. Il se sent presque coupable de ne pas ressentir la joie obligatoire, de ne pas réussir à se réjouir de ce qui devrait être une fête pourtant pour tous.
Dans son salon, la télé diffuse à chaque année aux actualités un reportage sur la grande parade qui s’organise à quelques coins de rue. Noah éteint le son.
Malheureusement, Noah ne comprend pas vraiment ce qui se joue derrière ses émotions ni l’origine de ce deuil saisonnier qui ne semble s’appuyer sur aucune cause précise. Il en a déjà parlé à un travailleur social de son CLSC (Centre local de services communautaires), mais après les cinq rencontres gratuites auxquelles il avait droit, il n’avait eu le temps que d’effleurer son passé familial, sans jamais entrer dans le cœur du problème, ni trouver le moindre soulagement.
Il existe pourtant des ressources
Pour une personne LGBTQ+ qui ressent une détresse émotionnelle, surtout pendant la période de la Fierté où l’inconfort peut s’amplifier, il existe plusieurs ressources, souvent complémentaires, qui peuvent offrir une écoute, un accompagnement et, dans certains cas, un suivi plus structuré.
Au Québec, beaucoup commencent par se tourner vers leur CLSC, car il offre un premier accueil psychosocial gratuit, parfois avec un travailleur social ou un intervenant communautaire. Lorsque l’aide ponctuelle ne suffit pas, certains CLSC peuvent orienter vers des psychologues ou des groupes de soutien communautaire. Ils les connaissent très bien et tiennent un registre de ces ressources.
Plusieurs organismes communautaires existent spécifiquement pour les réalités LGBTQ+, comme Interligne, qui offre un service d’écoute et de référence 24/7 par téléphone ou messagerie texte, et qui peut aussi mettre la personne en lien avec d’autres services. Il y a aussi des groupes comme le Projet 10, qui s’adressent particulièrement aux jeunes LGBTQ+ de 14 à 25 ans et proposent écoute, ateliers et soutien individuel ou collectif. Pour ceux qui vivent de l’isolement, des groupes de discussion ou des cafés-rencontres peuvent offrir un espace pour rompre la solitude et partager avec des pairs qui comprennent cette réalité. Une simple recherche sur Google en dénombre des dizaines selon la région du monde.
Certaines personnes choisissent de consulter un psychologue ou un psychothérapeute privé spécialisé en diversité sexuelle et de genre, quand c’est possible financièrement, ou d’explorer des ressources virtuelles comme des forums de discussion, des lignes d’écoute ou même des applications de soutien par messagerie.
On parle même de plus en plus des intervention psychologiques de ChatGPT qui peut assister une personne gratuitement et confidentiellement, c’est tout de même un début intéressant pour l’intelligence artificielle.
Enfin, quand le malaise devient insoutenable ou que la souffrance tourne à la crise, il ne faut jamais hésiter à contacter un service d’urgence comme le Suicide Action Montréal, le Centre de prévention du suicide de sa région ou, en dernier recours, composer le 911 si un danger immédiat existe.
Au-delà de ces ressources formelles, certaines personnes trouvent du réconfort à parler à un proche, à un membre de la communauté ou à un allié bienveillant, car parfois, c’est dans l’espace d’une simple conversation qu’un premier apaisement peut naître.
Régulièrement, à Gay Globe, en tant que responsable des communications du média, je reçois des courriels de personnes qui demandent de l’aide pour ces raisons. Je prends toujours soin de répondre le jour même, afin d’offrir un premier soutien et des pistes de solution à celles et ceux qui vivent une détresse. Cela fait aussi partie du rôle d’un média qui s’adresse aux communautés LGBTQ+.
Quelles sont les ressources au Canada anglais et en Europe ?
Dans le reste du Canada et en Europe, les personnes LGBTQ+ qui traversent ce type de détresse émotionnelle, surtout en période de Fierté, peuvent trouver de l’aide auprès de plusieurs réseaux bien établis, souvent gratuits ou peu coûteux, et adaptés à la diversité des situations.
Dans le Canada anglophone, un organisme très connu est The Trevor Project, qui, bien qu’américain à l’origine, offre aussi un soutien virtuel accessible au Canada pour les jeunes LGBTQ+. Pour une ligne d’écoute canadienne, Talk Suicide Canada (anciennement Service canadien de prévention du suicide) offre un soutien bilingue 24/7. Les grandes villes ont aussi leurs propres réseaux : Toronto Pflag et LGBT YouthLine en Ontario, par exemple, proposent écoute, information et groupes de soutien pour les jeunes et leurs familles. Les centres communautaires comme le 519 à Toronto ou le Centre for Sexuality à Calgary offrent souvent du counselling individuel et des groupes de parole. De nombreux campus universitaires ont aussi des services d’accueil LGBTQ+ pour leurs étudiants.
En Europe, l’offre varie selon le pays, mais plusieurs structures associatives ou nationales jouent un rôle clé. En France, SOS Homophobie tient une ligne d’écoute et accompagne les victimes de discriminations ou de violences, tandis que des associations comme Le Refuge soutiennent les jeunes LGBTQ+ rejetés par leur famille. Des réseaux comme Switchboard LGBT+ Helpline au Royaume-Uni offrent une écoute téléphonique et par messagerie depuis plusieurs décennies. Au Belgique, la RainbowHouse à Bruxelles et les Maisons Arc-en-Ciel dans différentes régions accueillent, orientent et organisent des groupes de parole.
Dans certains pays, la santé publique finance aussi des centres LGBTQ+ avec psychologues, travailleurs sociaux ou groupes de soutien gratuits ou à faible coût, souvent sous forme d’associations subventionnées. Dans toute l’Europe, la ligne d’urgence européenne 112 reste un recours immédiat en cas de crise.
Au-delà des numéros d’urgence, de plus en plus de jeunes utilisent aussi des applications de soutien anonyme ou des forums modérés, comme TrevorSpace ou des groupes Discord gérés par des associations, pour briser la solitude. Même à distance, ces espaces deviennent parfois un premier pas pour déposer un malaise trop lourd.
PUBLICITÉ