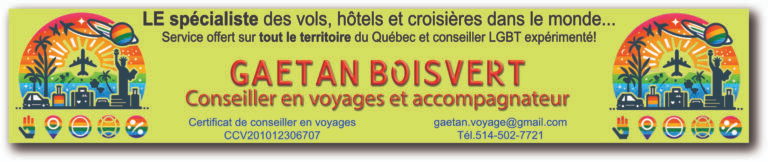Par : Gay Globe (Image : Couverture du rapport du Comité de sages)
NDLR : Il est très important de souligner, pour notre groupe média, que malgré plus de 32 ans de publication dans les médias LGBTQ+, non seulement nous n’avons jamais été consultés sur aucun aspect du contenu ou des recherches mentionnées dans ce rapport, mais nous ne connaissons pas non plus les trois membres de ce comité de sages, qui suscite la polémique depuis sa création.
L’oubli des médias LGBT dans le Rapport du Comité de sages : une omission révélatrice
Le Rapport du Comité de sages sur l’identité de genre – Volume 1, déposé au printemps 2025, se présente comme un exercice rigoureux et équilibré, cherchant à refléter la diversité des points de vue sur les enjeux liés à l’identité de genre au Québec. Pourtant, à la lecture attentive du document, une absence frappe : celle des médias communautaires LGBT.
Aucun nom de publication comme Fugues, Lez Spread the Word, Gay Globe ou autres revues ancrées dans l’histoire et la réalité de la diversité sexuelle et de genre n’est mentionné, et ce, ni dans les sources, ni dans les remerciements, ni dans les consultations citées. Or, ces médias jouent un rôle essentiel depuis des décennies dans l’information, l’éducation, la visibilité et le soutien des communautés LGBTQ+ au Québec. Ils sont souvent les premiers à donner la parole aux personnes concernées, à documenter les enjeux émergents, à dénoncer les injustices ou à expliquer les évolutions sociales et légales.
Cette omission soulève plusieurs questions. Peut-on brosser un portrait juste et complet de la diversité sexuelle et de genre sans reconnaître le rôle structurant de ses propres canaux d’expression? Peut-on prétendre à une écoute de la société civile en ignorant les plateformes qui, au fil des ans, ont permis cette parole libre et souvent militante?
Si le rapport a le mérite d’aborder avec nuance des sujets complexes et parfois polarisants, il aurait gagné à intégrer une reconnaissance du travail accompli par les médias LGBT québécois, tant sur le plan culturel que politique. Leur exclusion involontaire — ou délibérée — affaiblit la portée inclusive de l’exercice et soulève la nécessité de repenser la place qu’on accorde à la mémoire collective et à l’autoreprésentation des minorités sexuelles et de genre.
Introduction et mandat
En réponse aux tensions sociales grandissantes autour de l’identité de genre, le gouvernement du Québec a mis sur pied, en décembre 2023, un Comité de sages. Ce comité avait pour mandat de brosser un portrait global de la situation au Québec, de recenser les politiques existantes (dans les secteurs de l’éducation, la santé, les sports, etc.), d’analyser leurs effets sur la société et de formuler des pistes de réflexion. Le rapport repose sur une centaine de consultations avec des personnes concernées, des professionnels, des parents, des chercheurs et des groupes communautaires. Il vise une approche équilibrée, respectueuse de toutes les perspectives.
Chapitre 1 – L’identité de genre : un phénomène en évolution
Le rapport commence par distinguer le sexe (biologique, observé à la naissance) de l’identité de genre (expérience intime d’être homme, femme, les deux ou ni l’un ni l’autre). L’identité de genre est présentée comme un continuum, et non une catégorie fixe. Ce concept, relativement nouveau dans la sphère publique, fait l’objet de débats intenses, d’incompréhensions et parfois de méfiance.
Le Comité note une augmentation marquée des cas de dysphorie de genre, surtout chez les jeunes filles. Il évoque diverses hypothèses sans trancher sur une cause unique, rappelant l’importance d’une approche prudente et nuancée. La confusion fréquente entre les mots « sexe » et « genre », dans le langage courant comme dans les documents administratifs, complique les discussions et alimente des tensions sociales.
Chapitre 2 – Droits, discrimination et vie privée
Le Québec a connu plusieurs avancées légales : abandon de l’exigence chirurgicale pour changer de mention de sexe, ajout de l’identité de genre dans la Charte québécoise des droits, création du marqueur « X » pour les personnes non binaires. Ces réformes ont facilité l’inclusion juridique des personnes trans.
Cependant, le décalage entre les droits inscrits dans les lois et la réalité vécue sur le terrain demeure préoccupant. Le rapport souligne la persistance de la discrimination, notamment dans l’accès au logement, à l’emploi et aux soins de santé. Il appelle à une culture des droits, fondée sur l’éducation, la sensibilisation et l’accessibilité à la justice.
Le Comité insiste sur la clarté conceptuelle : les politiques doivent distinguer sexe biologique et identité de genre, sans pour autant les opposer. Cette distinction est cruciale, notamment pour des enjeux liés à la santé, à la recherche ou aux politiques publiques.
Chapitre 3 – Soins d’affirmation de genre
Les soins transaffirmatifs (hormonothérapie, chirurgie, soutien psychologique) sont abordés avec rigueur. Le Comité constate une forte augmentation de la demande, surtout chez les jeunes. Cela soulève des préoccupations liées à l’évaluation, au consentement, à la formation des professionnels et à la place des parents.
Les standards internationaux (comme ceux de la WPATH) servent de référence, mais le Québec manque encore de ressources spécialisées et d’uniformité dans l’offre de soins. Le Comité défend une approche individualisée mais encadrée, respectant l’autodétermination des personnes tout en maintenant une éthique professionnelle solide.
Il souligne la nécessité de mieux documenter les effets à long terme des soins de transition par des études longitudinales sérieuses. Il insiste également sur la différence entre les soins d’affirmation et les thérapies de conversion, interdites au Québec.
Chapitre 4 – Éducation et milieu scolaire
L’école est un lieu central dans l’expérience des jeunes trans ou non binaires. Le Comité rappelle le rôle crucial de l’éducation à la diversité pour créer un climat d’inclusion. Toutefois, des tensions émergent lorsqu’un élève effectue une transition sociale (changement de prénom, pronoms) sans que les parents en soient informés. Certains se sentent mis à l’écart de décisions importantes. Le Comité ne tranche pas sur la position idéale, mais appelle à un équilibre entre la confidentialité de l’élève et les droits parentaux, en fonction de l’âge et de la maturité de l’enfant.
Des efforts sont nécessaires pour former le personnel scolaire, assurer la cohérence des politiques et éviter que des jeunes soient victimes d’intimidation ou de rejet. L’école doit aussi être outillée pour accompagner les élèves en questionnement sans tomber dans des simplifications.
Chapitre 5 – Espaces genrés, détention, sport
L’accès aux espaces traditionnellement séparés selon le sexe (toilettes, vestiaires, prisons, équipes sportives) suscite de vifs débats. Le rapport traite des préoccupations liées à la sécurité, la vie privée et l’équité, autant pour les femmes que pour les personnes trans.
Dans les centres de détention, l’affectation des détenus trans demande un encadrement clair, car les risques de violence sont élevés. Le Comité appelle à évaluer chaque situation au cas par cas, avec rigueur.
Dans le milieu sportif, les obstacles sont nombreux : absence de politiques inclusives, peur du jugement, difficultés vestimentaires, etc. Le Comité souligne que l’organisation binaire du sport crée des dilemmes douloureux pour de nombreux jeunes trans. Il plaide pour des mesures d’adaptation souples, selon les disciplines et les niveaux de compétition.
Conclusion – Une recherche d’équilibre
Le Comité insiste sur une vérité essentielle : toutes les personnes consultées, peu importe leur opinion, partagent le désir d’un dialogue respectueux, de soins professionnels et d’un vivre-ensemble harmonieux. Les personnes trans ne forment pas un bloc homogène, pas plus que les voix critiques. Il est donc essentiel de dépasser les caricatures.
Le rapport invite à éviter la précipitation comme l’immobilisme, à agir avec prudence, mais aussi avec courage, en s’appuyant sur des données probantes et une volonté réelle de mieux comprendre. Il appelle le gouvernement à poursuivre ses réflexions dans un esprit d’écoute et d’ouverture, afin de faire du Québec un espace d’inclusion, de sécurité et de respect des droits pour tous.
PUBLICITÉ