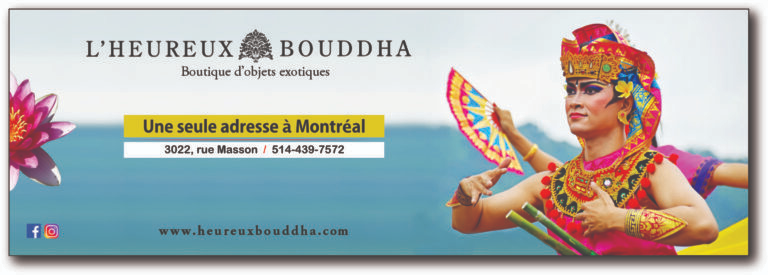Roger-Luc Chayer (Image: IA / Gay Globe)
Statistique Canada agit comme la mémoire chiffrée du pays. Cet organisme recueille, organise et analyse une masse impressionnante de données qui racontent l’évolution de la population, de l’économie, du travail, de la santé et de bien d’autres facettes de la société. Derrière chaque tableau et chaque pourcentage, il y a un effort constant pour offrir aux gouvernements, aux chercheurs et au public une vision aussi fidèle que possible de la réalité canadienne.
Ses enquêtes nourrissent les décisions politiques, inspirent des études universitaires, alimentent les médias et servent d’appui aux citoyens qui veulent comprendre les tendances qui façonnent leur quotidien. Sans cette machine à mesurer, le Canada avancerait un peu plus à l’aveuglette, privé d’une boussole statistique pour guider ses choix collectifs.
Nouvelle question sur l’orientation sexuelle
Par le passé, l’organisme avait tenté d’en savoir plus sur la question trans, mais pour le recensement de 2026, Statistique Canada souhaite mesurer le poids démographique réel des minorités sexuelles en demandant à chaque Canadien de divulguer son orientation sexuelle. Sur son site Internet, on définit ainsi l’orientation sexuelle : « L’orientation sexuelle réfère à la façon dont une personne décrit sa sexualité. Par exemple, une personne peut décrire sa sexualité comme hétérosexuelle, lesbienne, gaie, bisexuelle ou pansexuelle. » On ne traitera donc pas de l’identité de genre ni de la question trans.
L’idée est intéressante et pourrait, si le plan fonctionnait parfaitement, permettre à l’État fédéral de mieux connaître la représentation des personnes homosexuelles et de mieux cibler les services à leur offrir. Il en serait de même pour les gouvernements provinciaux ou municipaux. Et j’insiste bien : si le plan fonctionnait… Car le problème avec une telle question, jugée plutôt intrusive, est que de nombreux Canadiens, pour diverses raisons, refuseront d’y répondre ou indiqueront qu’ils sont hétérosexuels, simplement par habitude ou par souci de discrétion.
Ce n’est pas une question banale. À une époque où l’on constate partout dans le monde un effacement identitaire quasi génocidaire de la question LGBT, avec toutes les conséquences que cela peut avoir sur la vie des personnes concernées, nombreux sont ceux qui auront carrément peur de répondre à une telle question — et ils auront raison.
Pourquoi craindre de divulguer son orientation sexuelle ?
Répondre à une question sur son orientation sexuelle dans le cadre du recensement peut éveiller chez plusieurs un sentiment de vulnérabilité, même dans un pays qui se dit ouvert et inclusif comme le Canada. L’idée que cette information, aussi intime, se retrouve quelque part dans un système gouvernemental suscite une méfiance tenace, nourrie par l’histoire (nazis, fascisme, religions, exécutions) et l’actualité.
Beaucoup craignent que ces données, un jour, tombent entre de mauvaises mains ou servent à dresser des portraits collectifs qui pourraient être détournés à des fins discriminatoires. D’autres redoutent tout simplement que leur entourage découvre ce qu’ils préfèrent garder privé, par peur du jugement, du rejet ou de l’incompréhension. Et au fond, il y a ce réflexe profond de protéger ce qu’il y a de plus personnel, un espace intérieur que l’on ne confie pas facilement à une case à cocher, même si l’on promet que tout restera confidentiel.
Statistique Canada garantit que les renseignements recueillis lors de ses recensements sont confidentiels et protégés. Certes, mais ils sont aussi nominatifs, c’est-à-dire que les répondants sont identifiés par leur nom, leur adresse et plusieurs autres informations. On a beau promettre cette confidentialité, mais jusqu’à quand ? Et si un futur chef d’État décidait de s’en servir pour traquer ceux qu’il considérerait comme des ennemis de la nation, cela s’est déjà vu au Canada, dans un passé pas si lointain.
Quelle sera la fiabilité d’un recensement si une question fait peur ?
Il est très probable que les résultats du recensement concernant l’orientation sexuelle des répondants soient biaisés et peu représentatifs de la situation réelle. Même si certains croient qu’il s’agit là d’une bonne idée, une première preuve d’existence, un début ne sera jamais la réalité. Et si l’on doit prendre des décisions économiques en s’appuyant sur des données vagues et imprécises, ce recensement ne risque-t-il pas de devenir une arme à double tranchant, nuisant aux communautés gaies et lesbiennes en les sous-estimant par rapport à leur réalité sur le terrain ?
Au Canada, c’est obligatoire de répondre !
Au Canada, répondre au recensement est une obligation légale inscrite dans la Loi sur la statistique. Cette exigence est présentée comme un devoir civique, une façon de participer à la vie collective en fournissant des données essentielles pour planifier les services, les programmes et les politiques publiques.
Ne pas y répondre ou fournir de faux renseignements peut théoriquement entraîner des amendes, même si dans les faits, les poursuites restent plutôt rares. Cette obligation s’appuie sur l’idée qu’un portrait fidèle de la population est impossible si trop de gens choisissent de rester silencieux. Pourtant, malgré cette contrainte inscrite dans la loi, chaque recensement révèle des zones d’ombre, car certains préfèrent encore s’abstenir ou contourner les questions jugées trop intimes.
PUBLICITÉ