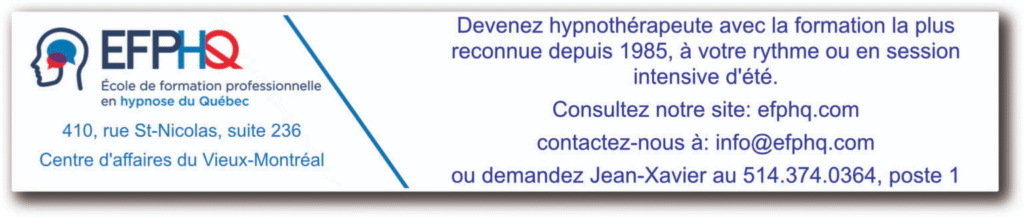Roger-Luc Chayer (Image : Meta IA / Gay Globe)
L’itinérance n’est pas une fin en soi ; elle résulte souvent de malchances accumulées, de dépendances ou d’un coup dur touchant l’emploi ou le logement. Même dans les pires situations, il existe des aides que Gay Globe souhaite faire connaître. Si l’on peut parfois prévenir l’itinérance, on peut aussi éviter d’y retourner avec les bons outils. Nous savons déjà que les jeunes des communautés LGBT sont surreprésentés en matière d’itinérance au Québec.
Droit à l’aide sociale pour les personnes itinérantes et toxicomanes
Une question nous a récemment été posée et des recherches ont été menées afin de déterminer si les personnes itinérantes et les toxicomanes avaient droit à l’aide sociale, ainsi que quels étaient les barèmes applicables aux prestations.
Il est essentiel de distinguer une personne itinérante ou sans-abri d’une personne souffrant de toxicomanie. Dans le premier cas, l’itinérance n’est pas nécessairement liée à des problèmes de santé. Dans le second, bien que la toxicomanie soit reconnue comme un problème de santé, cela ne signifie pas pour autant que les personnes concernées soient itinérantes. Vous me suivez ?
Contraintes à l’emploi selon le MTESS
Selon le cabinet Lambert Avocats, spécialisé dans les questions touchant l’aide sociale, “Le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) prévoit une indemnité supplémentaire pour les personnes dont la santé ou certaines situations limitent la capacité d’occuper un emploi. Cette reconnaissance de contraintes à l’emploi repose d’abord sur un rapport médical. Le médecin doit y indiquer si les problèmes de santé constituent une contrainte, en précisant s’il s’agit d’une limitation temporaire (moins de 12 mois) ou permanente (plus de 12 mois). Il doit aussi juger si la personne demeure apte à travailler ou à développer des habiletés professionnelles, estimer la durée de la limitation et évaluer la gravité, l’évolution et le pronostic de l’état de santé.
Une fois ce rapport déposé, l’aspect socio-professionnel du prestataire est également analysé : âge, niveau de scolarité et expériences professionnelles influencent l’évaluation. Par exemple, une même limitation physique n’aura pas le même impact sur une personne diplômée pouvant occuper un emploi de bureau que sur une autre dont les possibilités reposent sur un travail manuel. La loi parle ainsi de contraintes à l’emploi, et non d’inaptitude totale, distinguant ces critères de ceux utilisés par Retraite Québec.
Les contraintes temporaires à l’emploi ne sont pas uniquement médicales. Elles peuvent découler de la prise en charge continue d’un proche malade, de l’âge, ou encore de situations particulières comme la violence conjugale, qui peut ouvrir droit à une allocation supplémentaire pour une durée maximale de trois mois.
Enfin, les contraintes sévères à l’emploi, intégrées au Programme de solidarité sociale, concernent des problèmes persistants de plus de 12 mois, tels que la dépression, la toxicomanie ou le cancer. Si un prestataire reçoit une allocation temporaire au-delà d’un an, sa condition est généralement reclassée comme permanente. La démarche nécessite de demander au Centre local d’emploi un formulaire de reconnaissance de contraintes, à remplir par un médecin afin de confirmer l’admissibilité.”
La toxicomanie reconnue comme maladie au Québec
Oui, la toxicomanie ouvre la voie à une prestation augmentée.
Au Québec, la toxicomanie est reconnue comme une maladie, car elle repose sur des mécanismes biologiques, psychologiques et sociaux qui dépassent la simple question de volonté. Elle entraîne des modifications durables du cerveau, notamment dans les circuits de la récompense et du contrôle des comportements, ce qui explique la perte de maîtrise face à la consommation. Elle s’accompagne souvent de détresse psychologique, de souffrances physiques et de conséquences sociales graves. Cette approche médicale permet d’offrir aux personnes concernées un accès à des soins adaptés, à des traitements et à du soutien, plutôt que de les réduire à une faute morale.
Barèmes de l’aide sociale au Québec
Quels sont les barèmes offerts par l’aide sociale ?
Pour une personne seule jugée apte, l’aide mensuelle tourne autour de 829 dollars, un montant qui couvre à peine les besoins de base.
Lorsqu’une personne est reconnue comme ayant des contraintes sévères, elle entre dans le Programme de solidarité sociale, qui offre un soutien financier plus élevé. Dans ce cas, un adulte seul reçoit près de 1 300 dollars par mois.
À noter que les personnes en situation de contraintes sévères peuvent aussi, lorsque cela est possible, obtenir un logement en HLM, ce qui limite leur loyer à 25 % de leurs revenus et contribue ainsi à réduire le risque d’itinérance.
PUBLICITÉ