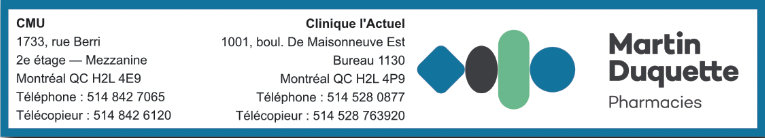Par: Arnaud Pontin (Photo : Pixabay)
Le stress minoritaire est un terme encore peu utilisé dans les médias, mais il devient de plus en plus pertinent à une époque où l’on remet en question l’essence même des communautés LGBTQ+ — je pense bien sûr à la vague d’effacement identitaire observée aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
Le stress minoritaire, c’est un peu le stress « en extra » que vivent les personnes qui appartiennent à un groupe marginalisé, comme les personnes gaies, lesbiennes, trans, etc. Ce n’est pas le stress normal du quotidien (factures, boulot, métro), mais celui qui vient du regard des autres, du jugement, des remarques, du rejet ou de l’homophobie.
Même quand rien ne se passe de grave, le cerveau reste souvent en mode vigilance, ce qui fatigue à la longue. Résultat : ça peut jouer sur le moral, la santé mentale, et même le corps. Ce stress s’accumule, surtout si on le vit dès l’enfance ou en silence.
Mais bonne nouvelle : avec le soutien, l’acceptation de soi, et des espaces bienveillants, on peut grandement diminuer ses effets. Bref, ce n’est pas «dans la tête» — c’est réel, mais ça se soigne avec de l’amour, de l’écoute… et parfois un bon thérapeute !
Le stress minoritaire, ça ne se voit pas toujours à l’œil nu, mais il est bien là, planqué dans les coins du quotidien. C’est ce petit malaise quand on s’autocensure avant de parler de son chum au bureau, ce doute sournois qui s’invite quand on entre dans une salle d’attente avec un médecin inconnu, ou encore cette fatigue qu’on traîne sans trop savoir pourquoi — comme un poids qu’on porte depuis longtemps sans l’avoir vraiment choisi.
Il se manifeste parfois par des insomnies tenaces, une irritabilité qu’on essaie de camoufler avec un sourire poli, ou ce besoin de décrocher du monde, juste pour souffler un peu. Parfois, on se surprend à douter de soi, à éviter les endroits où on ne se sent pas « à notre place », ou à surcompenser pour se faire accepter.
Bref, ce n’est pas une maladie, mais ça use à petit feu… comme un fond sonore qui ne s’éteint jamais. Beaucoup de personnes LGBTQ+ vivent une forme de stress minoritaire, souvent sans même mettre de mots dessus.
Ce stress touche une grande partie de la communauté, parce qu’il ne vient pas d’un événement isolé, mais d’une accumulation de petits et grands stress : devoir cacher une partie de soi, craindre le rejet, entendre des blagues douteuses, être jugé dans sa propre famille, ne pas voir de modèles positifs dans les médias, ou encore vivre dans une société où son existence est parfois politisée, niée ou attaquée.
Ce stress n’est pas le signe d’une faiblesse personnelle, mais plutôt la conséquence d’un environnement social qui reste, par moments, hostile ou insécurisant. Et même si les choses avancent dans certains endroits, les retours en arrière ailleurs — comme aux États-Unis ou en Europe de l’Est — rappellent à quel point ce stress est bien réel et partagé.
Pour aider une personne qui vit du stress minoritaire, il faut d’abord l’écouter sans juger, lui offrir un espace où elle peut respirer librement, être vue et crue. L’encourager à prendre soin de sa santé mentale, à s’entourer de bienveillance et à reconnecter avec ce qui la fait vibrer. Et si tout ça échoue… un bon câlin, un verre de bulles et un chat ronronnant font parfois des miracles !
PUBLICITÉ